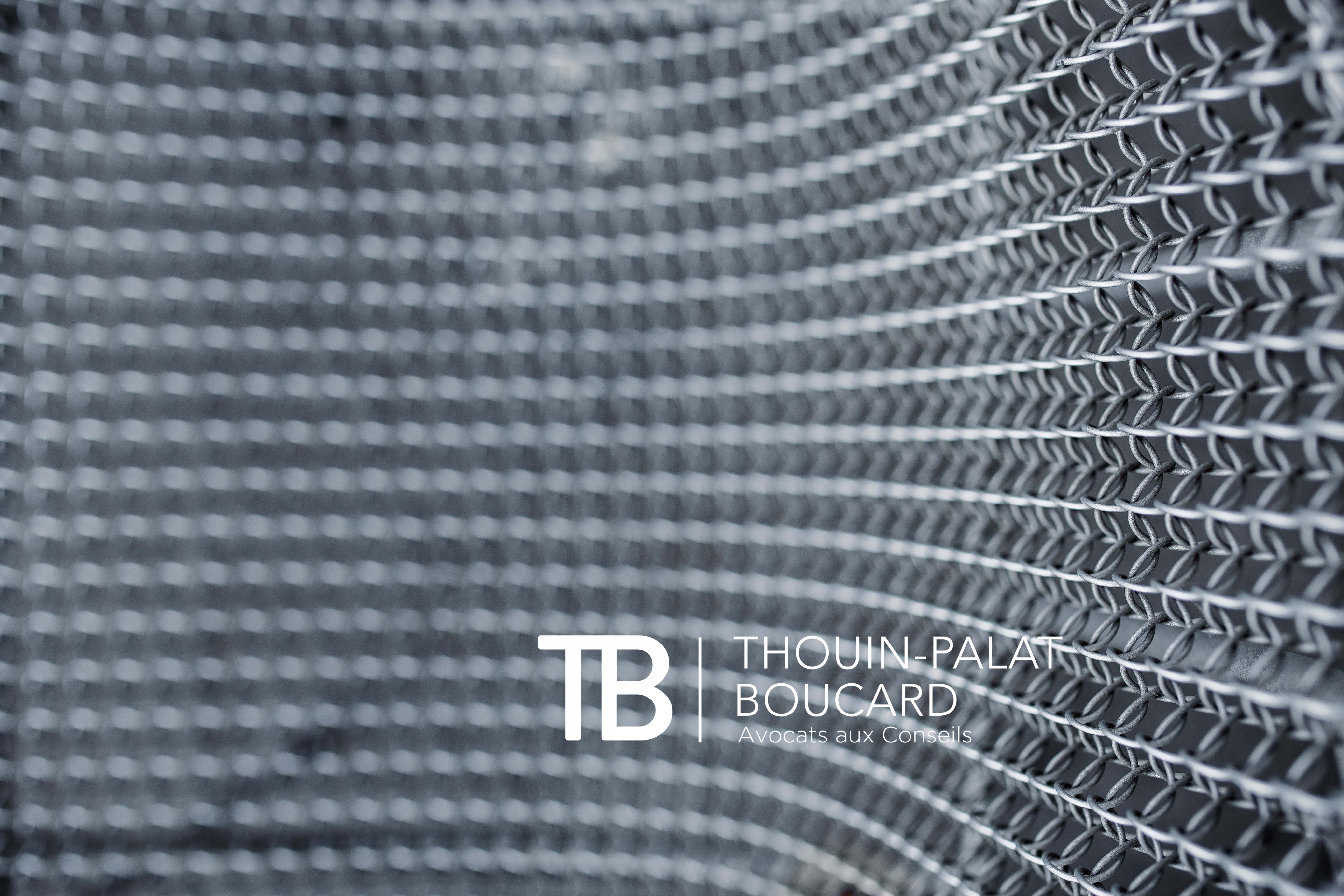Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC
Le 21 mars dernier, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 388 du code civil.
Cet article définit le mineur comme « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. »
Or, le droit français apporte une protection particulière aux mineurs non accompagnés[i] qui relèvent alors de l’Aide sociale à l’Enfance[ii]. Deux conditions doivent être remplies : l’individu doit être isolé[iii] et mineur.
Si la preuve de la première condition est éminemment difficile tant le parcours des enfants peut s’avérer chaotique, celle de la seconde l’est tout autant.
C’est pourquoi le texte en question prévoit la possibilité pour le juge judiciaire d’ordonner, si l’intéressé l’accepte, un examen osseux aux fins de détermination de l’âge.
Les tests osseux controversés
Ce type de test consiste principalement à effectuer une radiographie de la main et du poignet de l’individu dont on souhaite déterminer l’âge pour comparer cette photographie à des clichés de référence. L’échantillon de référence est notamment composé de tables de clichés d’une population nord-américaine décrite dans les années 30 et 40 dans l’atlas de Greulich et Pyle.
D’autres méthodes, comme celle de Tanner et Whitehouse, consistent à évaluer l’avancement morphologique de l’intéressé.
Outre qu’ils sont anciens, les clichés de référence ne portent que sur une population à l’origine géographique et sociale homogène. Pointant du doigt le manque de représentativité des individus testés, sa fiabilité est régulièrement remise en cause par des organismes nationaux, européens et internationaux.
De plus, les planches de référence n’avaient, lors de leur création, qu’une visée purement médicale puisqu’elles devaient servir à déceler des retards de croissance. Le procédé consistait alors à comparer l’âge biologique de l’enfant, déterminé par le test, à son âge chronologique pour vérifier la corrélation entre eux, mais il ne devait absolument pas permettre de déduire le premier du second. L’utilisation de cet examen à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu pose donc problème.
Pour ces raisons, techniques et éthiques, les tests radiologiques de détermination de l’âge ont fait l’objet vives critiques.
Déjà en novembre 2004, la Défenseure des Enfants (aujourd’hui, le Défenseur des droits) avait saisi le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) sur la question posée par le recours à des techniques radiologiques et à l’examen de l’état pubertaire à des fins d’estimation de l’âge d’un enfant ou adolescent sur un plan juridique.
Le Comité consultatif national d’éthique s’est alors prononcé le 23 juin 2005 en concluant à « l’inadaptation des techniques médicales utilisées actuellement aux fins de fixation d’un âge chronologique »[iv].
Encore, le Haut conseil de la santé publique et l’Académie de médecine ont souligné la faiblesse de cette méthode notamment entre 16 et 18 ans tant, à ces âges, le développement osseux varie d’un individu à l’autre[v].
Plus récemment encore, l’UNICEF a recommandé, en 2015, de « mettre un terme définitif, sur l’ensemble du territoire français, à la pratique des examens osseux ou d’autres examens uniquement physiologiques afin de déterminer l’âge des mineurs isolés et privilégier les bonnes pratiques onusiennes dans ce domaine. »[vi]
Pourtant, en 2016, le législateur a consacré, mais aussi encadré, le recours aux tests osseux en ces termes[vii] :
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » (Article 388 C. civ)
La remise en cause de ces tests devant les juridictions nationales
Interrogée sur la condition de minorité à plusieurs reprises, la Cour de cassation s’est retranchée derrière le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’analyse des éléments de preuve et de fait qui lui sont soumis[viii].
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’âge physiologique d’un individu placé par le juge des enfants dans le département de l’Ain depuis 2016. Considérant, au vu des résultats de l’expertise, que l’individu était mineur, cette même cour a, par arrêt du 3 juillet 2018, ordonné la mainlevée de la mesure de placement alors même que les autres éléments de preuve (documents de l’intéressé et évaluation) allaient dans le sens de sa minorité.
L’intéressé s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la Cour de cassation a décidé, après avoir vérifié que les conditions étaient remplies, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui était posée en ces termes : « L’article 388 du code civil méconnaît-il les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 en permettant le recours à des expertises osseuses, procédé dont l’absence de fiabilité a été soulignée par divers organismes internes et internationaux, pour déterminer la minorité de l’intéressé, minorité dont dépend, pour les mineurs étrangers, la protection des autorités françaises ? »[ix]
Ainsi, cette technique doit-elle être écartée en raison de son manque de fiabilité au risque de priver le juge d’un instrument utile à la détermination de l’âge ou bien son utilisation doit-elle être confirmée même s’il subsiste un risque d’écarter de la protection de l’Etat certains mineurs, tels étaient les enjeux en la cause.
Répondant à ces interrogations, le Conseil constitutionnel a consacré une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il n’a pas écarté le dispositif critiqué en estimant que les garanties qui l’entouraient étaient, sous réserve d’être correctement mises en œuvre, suffisamment protectrices de cet intérêt.
Consécration de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
Sur le fondement des alinéas 10[x] et 11[xi] du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel consacre, par cette décision, une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il en déduit que « les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures » (cons. 6) et donc écartées de la protection à laquelle elles ont droit.
Il lui revenait donc de vérifier que les garanties prévues par l’article 388 du code civil sont suffisantes à protéger cet intérêt supérieur.
Même s’il note que l’examen radiologique osseux comporte « une marge d’erreur significative » (cons. 7), le Conseil d’Etat valide la disposition contestée.
Pour ce faire, il reprend chacune des garanties prévues par le texte pour les expliciter :
- La première garantie tient au fait que seule l’autorité judiciaire peut ordonner le recours à un tel examen ;
- en outre, le Conseil constitutionnel relève que l’examen doit être subsidiaire et ne peut être ordonné qu’en l’absence de documents d’identité valables dès lors qu’il résulte de l’article 47 du code civil que les actes d’état civil établis régulièrement à l’étranger font foi. De plus, avant tout examen médical, une évaluation sociale du jeune doit être pratiquée ;
- selon le Conseil constitutionnel, l’intérêt de l’enfant est encore garanti par le nécessaire recueil du consentement libre et éclairé de l’intéressé et ce, sans que son refus ne puisse jouer contre lui ;
- enfin, la décision rappelle que la marge d’erreur attachée au résultat de l’examen doit y être mentionnée et, qu’après comparaison de ces résultats avec d’autres éléments, le doute subsistant sur l’âge de l’individu doit profiter à la qualité de mineur de ce dernier.
Mais, surtout le Conseil constitutionnel insiste sur la nécessité pour les autorités administratives et judiciaires compétentes de donner plein effet à ces garanties (Cons. 12).
Il répond, à ce titre, aux mises en garde formulées par diverses entités internes et internationales.
En effet, à l’occasion de la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel, le Défenseur des droits a réaffirmé son opposition ferme à l’utilisation des tests en cause. Ainsi, il a mis en lumière la faible valeur du consentement de l’individu qui, du fait de sa situation de potentiel mineur et d’étranger, est dans une position de vulnérabilité. Dans ses observations, il a aussi souligné la propension des magistrats à ordonner les tests osseux préalablement ou concomitamment à d’autres types d’évaluation et à les prendre en compte de manière prépondérante dans leur décision[xii].
Considérant lui aussi que ces garanties n’étaient pas effectives, le Comité européen des droits sociaux a indiqué, dans une décision du 24 janvier 2018, que l’« évaluation médicale de l’âge telle qu’appliquée peut avoir de graves conséquences pour les mineurs et l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés est inadaptée et inefficace » pour conclure que « le recours à ce type d’examen viole l’article 17§1 de la Charte »[xiii].
Rejet des autres griefs
La QPC transmise au Conseil constitutionnel invoquait aussi une atteinte au droit à la santé du potentiel mineur et une méconnaissance des principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et d’inviolabilité du corps humain.
D’une part, le Conseil constitutionnel exclut que la disposition contestée méconnaisse le droit à la santé de l’intéressé en se retranchant derrière l’appréciation du législateur en la matière. A ce titre, il considère que l’avis médical qui doit être recueilli avant de procéder à un tel examen est une garantie suffisante au regard de ce droit.
D’autre part, la disposition en cause ne méconnaîtrait pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain selon le Conseil constitutionnel qui estime que cet examen, qui ne peut être pratiqué qu’avec le consentement de la personne, n’implique « aucune intervention corporelle interne et ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. » (cons. 18).
Tous les griefs invoqués par le requérant sont ainsi rejetés.
A la suite de cette décision, il conviendra donc d’apprécier si, à l’avenir, les autorités compétentes feront respecter les garanties prévues par le texte dès lors que le Conseil constitutionnel les considère nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En toute hypothèse, cette décision pose de manière plus globale la question des relations qu’entretiennent la science et le droit et de la place qu’occupe la vérité scientifique dans le droit.
Liane Paget (stagiaire)
[i] Articles 375 et 375-5 du code civil ; Articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles
[ii] Le nombre de mineurs non accompagnés augmente fortement ces dernières années : « 14 908 personnes déclarées MNA en 2017 contre 8 054 en 2016 » – Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), Treizième rapport au Gouvernement et au Parlement, avril 2019.
[iii] Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2017, n° 17-24.072, à paraître au Bulletin. La Cour de cassation a précisé la notion d’isolement : « Attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ».
[iv] CCNE, avis n° 88, sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, 23 juin 2005
[v] Haut conseil de la santé publique, avis du 23 janvier 2014 relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé ; Académie de médecine, Rapport sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés, Janvier 2007 ; voir aussi : CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national, Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, 26 juin 2014 ; Comité des droits de l’enfant de l’ONU, observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France, 23 janvier 2016.
[vi] Rapport alternatif de l’UNICEF France et de ses partenaires dans le cadre de l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, « Chaque enfant compte. Partout, tout le temps », 2015.
[vii] La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
[viii] Par exemple : Cass. Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-13.383 et Cass. Civ. 1re, 13 décembre 2017, n° 17-26.212
[ix] Cass. Civ. 1re, 21 décembre 2018, n° 18-20.480
[x] Alinéa 10 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
[xi] Alinéa 11 : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »
[xii] Décision du Défenseur des droits n° 2018-296 ayant donné lieux aux Observations devant la Cour de cassation au soutien de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en application de l’article 33 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011.
[xiii] Comité européen des droits sociaux, Comité Européen d’Action Spécialisée pour l’Enfant et la Famille dans leur Milieu de Vie (EUROCEF) c. France, réclamation n° 114/2015, Décision du 24 janvier 2018 rendue publique le 15 juin 2018.